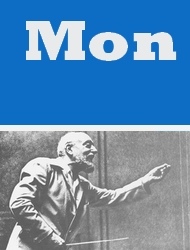Ernest ANSERMET, env.1965, photo de presse DECCA
publiée entre autres dans l'album Decca London CM 9438
Un mois plus tard, le compte-rendu du concert qu'Ivan MAHAIM publia dans La Gazette de Lausanne du 21 avril 1959, en page 5:
Ludwig van Beethoven, Grande Fugue en si bémol majeur, Op. 133, Orchestre de la Suisse Romande, Ernest Ansermet, 2 au 4 mai 1959, Victoria Hall, Genève
Overtura. Allegro - Meno mosso e moderato - Allegro - Fuga. Allegro -
Meno mosso e moderato - Allegro molto e con brio - Allegro 17:09